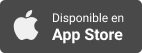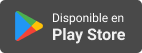Sinopsis
Le Campus Condorcet est un campus de recherche en sciences humaines et sociales porté par onze établissements et organismes de recherche français. Les Conférences Campus Condorcet sont organisées en cycles thématiques programmés de septembre à juin, à Aubervilliers. Données par des enseignants-chercheurs, les conférences sont aujourd'hui disponibles en podcast.
Episodios
-
La fin du capitalisme ?
11/06/2018 Duración: 56minThomas Piketty (EHESS) Conférence donnée dans le cadre du Cycle 2017/2018 des Conférences Campus Condorcet : « Un monde fini ? Environnement, croissance et croyances » - Dans cette conférence, Thomas Piketty s’interrogera sur la signification d’une possible « fin du capitalisme », ou plus précisément sur le type de transformation des rapports de propriété – ou de retour à des formes de rapports antérieurs – que sous-tendent les évolutions en cours. Pour cela, il remettra dans une perspective longue l’histoire des différentes formes de possession et de structures inégalitaires. Dans le prolongement des réflexions engagées dans son ouvrage « Le capital au xxie siècle », il s’interrogera en particulier sur la signification de tendances récentes telles que la remontée de la concentration des patrimoines et des revenus, l’interpénétration des détentions financières entre pays, la progression de la propriété immatérielle ou encore le développement de nouveaux propriétaires à but non lucratif.
-
Filmer la fin du monde, des origines du cinéma à la télévision
14/05/2018 Duración: 55minMyriam Tsikounas (Paris I) Conférence donnée dans le cadre du Cycle 2017/2018 des Conférences Campus Condorcet : « Un monde fini ? Environnement, croissance et croyances » - À l’évocation de la fin du monde au cinéma, ce sont des images de blockbusters américains et japonais qui nous assaillent, bien avant toutes réalisations françaises. C’est cette vingtaine de films, pour la plupart oubliés, échelonnés entre 1924 (La Cité foudroyée, Luitz-Morat) et 2011 (Melancholia, Lars von Trier), qui seront évoqués ici.Nous nous interrogerons sur les conditions de création de ces oeuvres, leurs filiations et contraintes budgétaires, qui ont obligé les auteurs à expérimenter des dispositifs ingénieux pour rendre crédibles, malgré l’absence d’effets spéciaux, la destruction de la planète et son éventuelle réorganisation.Nous observerons ensuite la manière dont ces récits ont évolué selon les connaissances, les enjeux, les inquiétudes des sociétés successives ; comment, selon les époques, les cinéastes ont présenté la pl
-
Anthropocène : quand l’histoire humaine rencontre celle de la Terre
09/04/2018 Duración: 01h02minJean-Baptiste Fressoz (CNRS) Conférence donnée dans le cadre du Cycle 2017/2018 des Conférences Campus Condorcet : « Un monde fini ? Environnement, croissance et croyances » - Les scientifiques nous l’annoncent, la Terre est entrée dans une nouvelle époque : l’Anthropocène. Ce qui nous arrive n’est pas une crise environnementale, c’est une révolution géologique d’origine humaine.Depuis la révolution industrielle, notre planète a basculé vers un état inédit. Les traces de notre âge urbain, consumériste, chimique et nucléaire resteront des milliers voire des millions d’années dans les archives géologiques de la planète et soumettront les sociétés humaines à des difficultés considérables. Faisant dialoguer science et histoire, cette conférence vise à donner une réponse historique à une question simple : comment en sommes-nous arrivés là ?
-
Fin du monde, effondrement de sociétés : peurs et résilience
12/03/2018 Duración: 57minSerban Ionescu (Paris VIII) Conférence donnée dans le cadre du Cycle 2017/2018 des Conférences Campus Condorcet : « Un monde fini ? Environnement, croissance et croyances » - Depuis les temps les plus reculés de l’histoire, la fin du monde a toujours hanté l’imaginaire des humains, ce thème étant aussi ancien que la peur de mourir. La disparition de l’humanité, telle qu’annoncée pour le 21 décembre 2012 dans « Le Facteur Maya », constituerait selon Luc Mary la 183e prédiction de ce genre… Face à la fréquence de cette annonce et à ses conséquences, les chercheurs ont tenté d’avancer des explications : catharsis pour les angoisses quotidiennes, toujours plus grandes dans le monde actuel ? Expression de pathologies collectives ? Stratégie de manipulation et d’emprise sectaire pour des personnes vulnérables ?La diversité des hypothèses avancées concernant l’effondrement des sociétés et la fin du monde témoigne de la complexité de ce type de peur et souligne la nécessité d’envisager des interventions permettant
-
La fin de l’empire soviétique était-elle inévitable ?
12/02/2018 Duración: 01h11minMarie-Pierre Rey (Paris I) Conférence donnée dans le cadre du Cycle 2017/2018 des Conférences Campus Condorcet : « Un monde fini ? Environnement, croissance et croyances » - En décembre 1991, un peu plus de cinq ans après l’avènement de la Perestroïka gorbatchévienne qui s’était donné pour objet de la réformer en profondeur, l’Union soviétique implosait, entraînant avec elle, non seulement l’écroulement de la plupart de ses institutions mais également la disparition d’un univers mental qui participait de la légitimité du pays et en assurait la cohésion sociale. Sur le plan extérieur, les changements furent tout aussi rapides : désormais privé des références idéologiques qui avaient contribué à son expansion, contraint de renoncer au glacis est-européen et au réseau d’États clients du Tiers Monde qui lui avaient conféré une grande partie de sa puissance, le nouvel État russe se retrouva en quelques mois affaibli dans ses capacités d’influence, en proie à une profonde crise identitaire et exposé par ses nouve
-
Apocalypse et millénarisme dans l’histoire européenne
15/01/2018 Duración: 01h19minJean-Claude Schmitt (EHESS) Conférence donnée dans le cadre du Cycle 2017/2018 des Conférences Campus Condorcet : « Un monde fini ? Environnement, croissance et croyances » - Apocalypse, eschatologie, messianisme, millénarisme : pour comprendre ces mots toujours actuels, il faut remonter à leur source.Parmi les nombreuses révélations visionnaires qui fleurissent dans les milieux judéo-chrétiens entre le IIe siècle av. J.-C. et le premier siècle de notre ère, l’Apocalypse attribuée à Jean l’Évangéliste a joui d’un succès considérable qui ne s’est jamais démenti dans la tradition chrétienne depuis l’Antiquité tardive jusqu’au XVIIIe siècle au moins. En commentant ce texte et en le mettant en images, des générations de croyants ont spéculé sur la prédiction d’un retour sur terre du Messie (Parousie) à une date incertaine et ont vécu dans l’espérance d’un règne de paix de mille ans (millénium) précédant le Jugement dernier.Les interprétations divergentes quant à la date et à la nature du millénium ont donné lie
-
Expériences et imaginaires de la fin du monde au XXe siècle
18/12/2017 Duración: 01h27sGiordana Charuty (EPHE) Conférence donnée dans le cadre du Cycle 2017/2018 des Conférences Campus Condorcet : « Un monde fini ? Environnement, croissance et croyances » - Au début des années 1960, l’anthropologue italien Ernesto De Martino entreprend une vaste enquête comparative sur les ressources culturelles offertes par plusieurs imaginaires de la fin du monde ou de la fin de l’Histoire : celui du christianisme primitif, celui des mobilisations millénaristes du Tiers Monde, celui du mouvement communiste international, celui de la modernité artistique et littéraire.Une définition de la culture comme ce qui préserve de la folie – entendue comme perte du rapport à soi et au monde – est au cœur de cette entreprise, qui fait suite à dix ans d’enquêtes ethnographiques dans l’Italie du Sud pour comprendre la rémanence de savoirs culturels, disqualifiés sous le nom de magie, destinés à prendre en charge des crises de l’existence individuelle.Mais la mélancolie de l’Occident aux prises avec des mondes finissants
-
7 milliards et demi d’humains en 2017… et combien demain ?
16/10/2017 Duración: 43minGilles Pison (INED) Conférence donnée dans le cadre du Cycle 2017/2018 des Conférences Campus Condorcet : « Un monde fini ? Environnement, croissance et croyances » - Sept milliards et demi d’humains en 2017… et combien demain ? Pendant des milliers d’années, l’homme a été une espèce rare dont le nombre augmentait lentement. Vers 1800cependant, la population s’est mise à croître rapidement, d’abord dans les pays riches puis, à partir du XXe siècle, dans les pays pauvres. Cette période unique dansl’histoire de l’humanité devrait se terminer d’ici la fin de ce siècle ou au cours du XXIIe siècle.Quelles ont été les raisons de cette formidable croissance démographique ? Va-t-elle se poursuivre ? Comment s’explique la stabilisation annoncée ? À quoi ressemblera la population mondiale demain ?
-
Un monde fini ? Le développement économique face à la crise environnementale depuis les années 1960
18/09/2017 Duración: 51minDominique Pestre (EHESS) Conférence donnée dans le cadre du Cycle 2017/2018 des Conférences Campus Condorcet : « Un monde fini ? Environnement, croissance et croyances » - La question environnementale devient centrale dans les années 1960. Elle est popularisée par des lanceurs d’alerte scientifiques et de nouvelles ONG. Les hommes politiques se saisissent de la question vers 1970 et agences et ministères sont créés. Les économistes sont placés en position de responsabilité et est énoncé le principe qu’il n’y a pas d’opposition entre croissance économique et protection de l’environnement.Vingt ans plus tard, du fait de la globalisation et de l’explosion des productions, la destruction des environnements paraît incontrôlable. Les grandes entreprises déclarent changer d’attitude et se mettre au coeur de la défense de l’environnement via un nouveau management et la mise en place d’audits. Une part d’entre elles, soutenues par les Républicains aux États-Unis, se lancent toutefois dans le climato-scepticisme et d
-
La diaspora juive. Histoire et interprétations
12/06/2017 Duración: 37minMaurice Kriegel (EHESS) Conférence donnée dans le cadre du Cycle 2016/2017 des Conférences Campus Condorcet : « Mobilité et migrations dans le monde et dans l’histoire » -La conférence se fixera un double objectif. D’abord, présenter l’histoire de l’éclatement diasporique : en remontant à ses origines, dès l’effondrement des royaumes d’Israël et de Juda aux temps bibliques ; en mesurant l’impact exact de la destruction du Temple de Jérusalem en l’an 70 sur la formation durable du fait diasporique ; en insistant, du point de vue des réimplantations géographiques, sur les principales scansions de cette longue histoire des diasporas. Ensuite, décrire l’univers de représentations liées à la dispersion - ses invariants comme ses renouvellements : binôme « exil et rédemption » ; explications théologiques de « l’exil », dans leur diversité ; discours concurrents nés lors des deux derniers siècles, à la suite de « l’émancipation » et de l’accession des juifs à la citoyenneté, selon les différents courants religieux
-
Des « Grandes Invasions » aux « Migrations des Peuples » : histoire et usages idéologiques
15/05/2017 Duración: 55minGeneviève Bührer-Thierry (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Conférence donnée dans le cadre du Cycle 2016/2017 des Conférences Campus Condorcet : « Mobilité et migrations dans le monde et dans l’histoire » -L’image de la fin d’un empire romain décadent submergé par des hordes de barbares aux mœurs complètement différentes a été forgée au XVIIIe siècle, mais reste, aujourd’hui encore, très prégnante. Même si tous les historiens ne s’accordent pas sur toutes les questions soulevées par cette évolution, la remise en perspective des « grandes invasions » a permis de montrer toute la charge idéologique attachée à cette notion. L’objet de cette conférence sera de montrer comment s’est construite l’image des « grandes invasions », d’étudier les usages idéologiques qui en ont été faits notamment au XIXe siècle et d’évoquer les nouvelles interprétations de ce phénomène : on insiste désormais sur la lente construction d’une société « romano-barbare » au sein de laquelle les « Barbares » se sont progressivement acc
-
Vers une explosion des « migrations climatiques » ?
24/04/2017 Duración: 49minJacques Veron (Ined) Conférence donnée dans le cadre du Cycle 2016/2017 des Conférences Campus Condorcet : « Mobilité et migrations dans le monde et dans l’histoire » -Une des conséquences majeures attendues du changement climatique est la montée du niveau de la mer, qui condamnera des populations de régions côtières ou d’îles sans relief à une migration forcée et définitive. Ces migrants quittant leur lieu de vie pour une raison liée au climat sont fréquemment qualifiés de « réfugiés climatiques », même si cette expression ne semble pas appropriée. Si le changement climatique se traduit aussi par des événements extrêmes plus fréquents, les déplacements de populations seront dans l’avenir de plus en plus nombreux, mais tout déplacement n’est pas une véritable migration. Les populations peuvent également adopter d’autres stratégies qu’une migration définitive en cas d’inondation ou de sécheresse de grande ampleur par exemple. Dans ces conditions, va-t-on vers une explosion des migrations climatiques ou plutôt
-
Quelle place pour les mémoires des migrations à la Plaine-Saint-Denis ?
20/03/2017 Duración: 01h03minEvelyne Ribert (CNRS) Conférence donnée dans le cadre du Cycle 2016/2017 des Conférences Campus Condorcet : « Quelle place pour les mémoires des migrations à la Plaine-Saint-Denis ? » -Au cours des XIXe et XXe siècles, de nombreux immigrés se sont installés à la Plaine Saint-Denis. Alors que les initiatives visant à conserver et à valoriser les mémoires des migrations se multiplient en France, quelle place leur est accordée aujourd’hui dans ce quartier en pleine transformation sous l’effet de la rénovation urbaine ? Cette conférence prendra pour exemple le cas du secteur Cristino-Garcia-Landy, dénommé « la petite Espagne ». À partir de l’analyse des actions mémorielles menées d’un côté par la FACEEF, fédération d’associations espagnoles, de l’autre par la maison de quartier du Landy autour de la mémoire du quartier avec la réalisation d’une fresque et d’un livre, il s’agira de s’interroger sur les enjeux et les effets de ces initiatives. Quelles mémoires des migrations sont mises en avant ? Quels usages en f
-
L'hospitalité dans la langue de l'autre ou ce que peut la littérature
20/02/2017 Duración: 46minMireille Calle-Gruber (Université Sorbonne Nouvelle Paris 3) Conférence donnée dans le cadre du Cycle 2016/2017 des Conférences Campus Condorcet : « Mobilité et migrations dans le monde et dans l’histoire » -« Un acte d’hospitalité ne peut être que poétique », déclarait le philosophe Jacques Derrida. En faisant de la littérature un acte d’hospitalité, les écrivains francophones du Maghreb — ainsi Assia Djebar, Abdelkebir Khatibi — ou liés au Maghreb et parfois même nés en France ou d’une génération plus jeune — ainsi Nina Bouraoui —, ont donné à la création littéraire ses lettres de noblesse à la fois poétiques et politiques. À partir de 1950, l’écriture dans la langue de l’ex-colonisateur travaillant à la croisée des langues et inventant des formes hybridées, donne naissance à des œuvres fortes et singulières qui retraversent l’histoire douloureuse, le passif colonial et le ressentiment.Elles se confrontent à la mémoire collective et aux récits biographiques, posent la question de la prise de parole des fem
-
Musulmans « ordinaires » d’Europe
16/01/2017 Duración: 58minNilüfer Göle (EHESS) Conférence donnée dans le cadre du Cycle 2016/2017 des Conférences Campus Condorcet : « Mobilité et migrations dans le monde et dans l’histoire » -La figure du migrant musulman en Europe est un sujet problématique, pris entre le djihadisme, l’échec d’intégration et l’incompatibilité des valeurs. Depuis les années 1980, indépendamment des différences nationales entre les modèles politiques d’intégration des migrants, notamment le modèle républicain et le multiculturalisme, l’islam pose problème et déclenche une série de controverses autour des signes du religieux. Ces débats attestent la présence des musulmans dans la vie quotidienne en Europe, leur intégration en cours et leur désir de participation aux affaires de la cité.Qui sont ces musulmans au quotidien ? Comment vivent-ils les tensions entre leur visibilité islamique et leur citoyenneté ? C’est en interrogeant le processus en cours de transformation des migrants en musulmans « ordinaires », que nous examinerons le domaine de la con
-
Le modèle d’intégration et la France multiculturelle
12/12/2016 Duración: 01h06minPatrick Simon (Ined) Conférence donnée dans le cadre du Cycle 2016/2017 des Conférences Campus Condorcet : « Mobilité et migrations dans le monde et dans l’histoire » -Il est banal d’affirmer en 2016 que la France est une société multiculturelle, c’est-à-dire que l’ampleur de la diversité ethnique et sociale de sa population transforme le cadre de société aux niveaux interpersonnels, institutionnels et nationaux. La plupart des débats politiques et de société de ces trente dernières années sont marqués par cette dimension. Non seulement la « question de l’immigration » s’est imposée au cœur de l’agenda politique, mais la diversité croissante de la population suscite des tensions autour de l’adaptation de la société française. L’actualisation du modèle politique et des représentations collectives, ce que l’on appelle l’identité nationale, est en jeu. Une société multiculturelle donc, mais qui en partie s’ignore, ou pour le dire autrement, où le pluralisme des références et pratiques culturelles font l’objet d
-
Politiques migratoires et droits de l’Homme : une conciliation impossible?
28/11/2016 Duración: 59minDanièle Lochak (Université Paris Nanterre) Conférence donnée dans le cadre du Cycle 2016/2017 des Conférences Campus Condorcet : « Mobilité et migrations dans le monde et dans l’histoire » -Peut-on concilier les impératifs auxquels obéissent aujourd’hui les politiques migratoires et les modalités de leur mise en œuvre avec le respect des droits de l’homme ? La question renvoie à une interrogation classique du droit international, qui prend aujourd’hui une intensité et une actualité particulières : jusqu’à quel point les États peuvent-ils invoquer leurs prérogatives souveraines pour faire obstacle à la libre circulation des personnes et entraver ainsi l’exercice d’une série de droits fondamentaux ? On se trouve ici face à un paradoxe : alors même que, tirant les conséquences du caractère universel des droits de l’homme, on a fini par admettre que leur jouissance devait être assurée sans considération de nationalité, les impératifs de la maîtrise des flux migratoires conduisent non seulement à justifier des re
-
Migrations de dissidents religieux sous Louis XIV : exils et asiles des huguenots en Europe.
17/10/2016 Duración: 51minHubert Bost (EPHE) Conférence donnée dans le cadre du Cycle 2016/2017 des Conférences Campus Condorcet : « Mobilité et migrations dans le monde et dans l’histoire » -La révocation de l’édit de Nantes (1685) interdit le protestantisme en France, mais Louis XIV y prohibe aussi à tous ses sujets désormais « nouveaux catholiques » de quitter le royaume. Refusant de renoncer à leurs convictions religieuses, quelque 150 000 huguenots s’exilent pourtant à cette époque vers les pays protestants - Angleterre, Provinces-Unies, Suisse, Allemagne – qui les accueillent avec plus ou moins d’enthousiasme. Ce déplacement de population vers le «Refuge huguenot», avec les transferts technologiques qui l’accompagnent, les débats politico-philosophiques qu’il suscite, le rôle qu’il joue dans l’histoire médiatique et dans la naissance de l’« opinion publique », constitue un phénomène historique complexe, qui influera profondément sur la définition des « Lumières » en Europe.
-
L'immigration en débat : un dialogue de sourds ?
19/09/2016 Duración: 01h08minFrançois Heran (Ined) Conférence donnée dans le cadre du Cycle 2016/2017 des Conférences Campus Condorcet : « Mobilité et migrations dans le monde et dans l’histoire » - L’immigration est devenue un objet central du débat public, en France comme ailleurs. On parle régulièrement de « dépassionner » la question, mais la controverse n’épargne pas les méthodes réputées objectives, comme la démographie ou le fact-checking. On reviendra ici sur les argumentaires les plus utilisés pour ou contre l’immigration. Arguments sécuritaires ou humanitaires, utilitaristes ou déontologiques, souverainistes ou mondialistes. Modèle de l’« assimilation » opposé au modèle de l’« intégration ». Peur de la perte d’identité et du « grand remplacement » ou, inversement, célébration des bienfaits de la « diversité ». Accusations mutuelles de cynisme et d’angélisme… Que valent ces arguments ? Pourquoi est-il si difficile de les confronter aux faits ? Est-il vain d’espérer que le débat démocratique sur l’immigration puisse échapper un